« Il faut en finir avec ces bêtes immondes, avec ces barbares des temps obscurs, ces porteurs de ténèbres, oublier les serments pleins d'orgueil et de morgue qu'ils ont réussi à nous extorquer au sortir de ces années de guerre. La lumière n'est pas avec eux et les lendemains ne chantent jamais que pour les hommes libres. » (Boualem Sansal, le 25 août 1999).
C'est le journal "Marianne" qui a donné l'alerte dans son édition du 21 novembre 2024 : l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal aurait "disparu" lorsqu'il est rentré en Algérie le 16 novembre 2024. Il aurait été arrêté par la police algérienne à l'aéroport d'Alger pour "atteinte à l'unité nationale" et serait ainsi enfermé dans une prison algérienne. Selon ces journalistes, on reprocherait à Boualem Sansal ses propos tenus le 14 novembre 2024 (écouter la première vidéo ci-dessous) : « Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc : Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Toute cette région faisait partie du royaume. ». Crime de lèse-mythe !
Cette arrestation est d'autant plus scandaleuse que l'écrivain vient d'avoir 75 ans le mois dernier. Rappelons très rapidement qui il est : après de brillantes études et un doctorat en économie, Boualem Sansal a travaillé comme haut fonctionnaire de son pays ainsi qu'un universitaire, et il est devenu un romancier à succès à partir du 25 août 1999 avec la sortie de son premier roman "Le Serment des barbares" (éd. Gallimard), début d'une longue série d'ouvrages qui ont reçu de très nombreuses récompenses (dont le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2015). Parmi ses livres (une quarantaine dont certains en coécriture, notamment avec Philippe Val), on peut notamment citer quatre romans, "Le Village de l'Allemand ou Le Journal des frères Schiller" (éd. Gallimard, 3 janvier 2008), où il fait l'analogie entre islamisme et nazisme, "2084 : la fin du monde" (éd. Gallimard, 20 août 2015), "Le Train d'Erlingen ou La Métamorphose de Dieu" (éd. Gallimard, juin 2018), "Vivre : le compte à rebours" (éd. Gallimard, 2024), ainsi qu'un essai, "Le français, parlons-en !" (éd. du Cerf, 2024).
Homme terriblement libre, le George Orwell algérien, Boualem Sansal ne mâche jamais ses mots et est très franc, ce qui fait qu'il ne se fait pas que des amis (la preuve avec son arrestation). Il affirmait notamment, le 23 octobre 2018 sur France Culture : « Pour les bien-pensants, critiquer l'islamisme, c'est critiquer l'islam. ». Il a sorti "2084" quelques mois après la sortie de "Soumission", le roman de Michel Houellebecq qui, finalement, évoque la même chose : l'arrivée au pouvoir des islamistes.
Cela a fait de lui un intellectuel solide et surtout indépendant, ce qui est finalement assez rare aujourd'hui. Il n'est pas à l'abri de déclencher des polémiques, comme lorsqu'il défendait le 25 décembre 2023 la présomption d'innocence de Gérard Depardieu (ce qui, d'ailleurs, me paraissait sage). Amoureux de la langue française (il n'écrit que dans cette langue), l'écrivain algérien a obtenu la nationalité française cette année, en 2024, afin de s'installer en France où sa femme (ancienne professeure de mathématiques à Boumerdès), très malade, est hospitalisée.
Le pessimisme de l'auteur franco-algérien paraît très fort lorsqu'il a lâché, le 4 septembre 2015, envisageant une dictature mondialisée des islamistes : « Dans cinquante ans, il n'y aura plus de pétrole et le problème de la répartition des richesses sera encore accru. Il faudra mettre en place un système encore plus coercitif. Une dictature planétaire, non plus laïque mais religieuse, pourrait alors se substituer au système actuel qui devient trop compliqué à cause de la raréfaction des ressources. ».
C'est un grand intellectuel qui a beaucoup d'influence parce qu'ils sont peu nombreux, en Algérie (et en France), à critiquer autant le pouvoir autocratique algérien. Boualem Sansal est un athée qui s'attaque principalement à l'islamisme, mais aussi aux mythes d'une Algérie qui, selon lui, n'a historiquement jamais vraiment existé. Il adore la France, mais, semble-t-il, la France d'il y a cinquante ans, et il regrette la dilution de l'identité française dans l'idée européenne et plus généralement dans un "Occident" uniformisé : « J'étais partout et nulle part, tout se ressemble, le tsunami de la mondialisation a gommé nos héritages, effacé nos traits intimes, on ne reconnaît ni les siens ni les autres. » ("Le Village de l'Allemand").
Le vrai scandale est que Boualem Sansal est désormais en prison pour avoir prononcé quelques phrases auxquelles le pouvoir algérien s'opposerait, comme si le débat des idées devait se faire en prison et pas dans les médias. Un scandale annexe en France est que les milieux politico-médiatiques de gauche ont généralement du mal à s'émouvoir de cette arrestation arbitraire sous prétexte qu'il ne développerait pas des idées "conformes" à leurs vues.
Personnellement, j'apprécie la position de Boualem Sansal sur l'islamisme et le risque d'une islamisation en France (ce qui le classerait faussement dans le camp de l'extrême droite alors que la menace islamiste n'est plus à prouver depuis l'assassinat d'enfants en bas âge juifs en mars 2012). En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec son déclinisme nostalgique de la France et des critiques qu'il émet contre Emmanuel Macron, que je trouve injustes car certaines évolutions de la France ne sont évidemment pas de son fait (loin de là) et même parfois il tente de s'y opposer (c'est d'ailleurs à se demander si cet antimacronisme primaire n'était pas une commande de la revue supposée s'appeler "Front populaire", tant les idées exprimées dans son interview d'octobre 2024 me paraissaient très simplistes alors qu'en même temps, il a une réflexion solide sur d'autres sujets). Du reste, j'espère très vivement que le Président de la République Emmanuel Macron, autrement que par un tweet, prendra des mesures diplomatiques pour réclamer efficacement la libération immédiate de Boualem Sansal.
Je propose ici, par deux voies, de l'écouter (je propose six vidéos en fin d'article où il a le temps de développer ses idées) et de le lire pour comprendre la pensée qu'il exprime, au moyen de quelques extraits sur des sujets importants.
Sur le mythe fondateur de l'Algérie : « Je suis un iconoclaste qui dénonce les mensonges de la guerre de libération. J'ose toucher à un mythe fondateur, mais un mythe est fait pour être discuté. L'Algérie a été construite par la France dont elle porte les valeurs du XIXe. Alger est une ville squattée. Ils sont loin d'avoir trouvé les clés. Aujourd'hui, elle tourne le dos à la Méditerranée en regardant vers l'Iran et les pays arabes. Chez nous [en Algérie], les politiques s'expriment comme des imams ténébreux. La France est le centre du monde par son immense culture et sa liberté. C'est le pays de l'équilibre par excellence. La liberté est une notion riche et profonde en Occident. Ici, en guise de liberté, c'est le foutoir, l'apostrophe, l'insulte et la bagarre de rues. » ("Le Serment des barbares", 1999).
Sur le pouvoir politique en Algérie : « Reconstituer un monde disparu est toujours à la fois une façon de l'idéaliser et une façon de le détruire une deuxième fois puisque nous le sortons de son contexte pour le planter dans un autre et ainsi nous le figeons dans l'immobilité et le silence ou nous lui faisons dire et faire ce qu'il n'a peut-être ni dit ni fait. Le visiter dans ces conditions, c'est comme regarder le cadavre d'un homme. » ("2084 : la fin du monde", 2015).
Sur Abdelaziz Bouteflika : « Bouteflika est un autocrate de la pire espèce (…). C'est pourtant lui que les grandes démocraties occidentales soutiennent et à leur tête la France de Sarkozy. (…) Je pense souvent à l'exil mais où, chez Bush, chez Sarkozy ? Remplacer un malheur par un autre n'est pas ce qu'on peut appeler une bonne décision. » (le 13 mars 2008, interview à Rue89).
Sur la colonisation française : « Comme 80% des Algériens [je suis nostalgique de la présence française]. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes nostalgiques de la colonisation. Mais au temps de la présence française, l'Algérie était un beau pays, bien administré, plus sûr, même si de criantes inégalités existaient. Beaucoup d'Algériens regrettent le départ des pieds-noirs. S'ils étaient restés, nous aurions peut-être évité cette tragédie. » (le 18 septembre 1999, interview dans "Le Figaro").
Sur l'islam : « L'islam (…) se situe par essence dans le champ politique. Le prophète Mahomet est un chef d'État et un chef de guerre qui a utilisé sa religion à des fins tactiques et politiques. Par ailleurs, les textes eux-mêmes ont une dimension totalitaire puisque la charia (loi islamique), qui se fonde sur les textes sacrés de l'islam que sont le Coran, les hadiths et la Sunna, légifère sur absolument tous les aspects de la vie. » (le 4 septembre 2015, interview dans "Le Figaro").
Sur l'islamisme en France : « [Les Algériens sont] inquiets parce qu’ils constatent jour après jour, mois après mois, année après année, que la France ne sait toujours pas se déterminer par rapport à l’islamisme : est-ce du lard, est-ce du mouton, est-ce de la religion, est-ce de l’hérésie ? Nommer ces choses, elle ne sait pas, c’est un souci. Pendant ce temps, le boa constrictor islamiste a largement eu le temps de bien s’entortiller, il va tout bientôt l’étouffer pour de bon. » (le 13 décembre 2016, interview à la Fondation Varenne).
Une année auparavant, il disait déjà : « L'islamisation est en marche et connaît une accélération notable. Chacun peut l'observer. Aujourd'hui, l'islamisation est l'affaire de professionnels de la prédication, de la manipulation et des médias, dont Internet. Elle a des buts politiques offensifs. La masse critique qui déclenchera la réaction en chaîne n'est pas loin d'être atteinte. Elle posera d'énormes et insolubles problèmes en Europe. » (le 15 janvier 2015, interview à "Valeurs Actuelles").
Dans "Le Village de l'Allemand" : « Arrêter l'islamisme, c'est comme vouloir attraper le vent. Il faut autre chose qu'un panier percé ou une bande de rigolos comme nous. Savoir ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Il nous manque une chose que les islamistes ont en excès et que nous n'avons pas, pas un gramme : la détermination. » (2015). Dans le même livre : « Il a compris que l’islamisme et le nazisme, c’était du pareil au même. Il a voulu voir ce qui nous attendait si on laissait faire comme on a laissé faire en Allemagne, à Kaboul et en Algérie où les charniers islamistes ne se comptent plus, comme on laisse faire chez nous, en France où les gestapos islamistes ne se comptent plus. ». Ou encore, pour être encore plus clair : « Hitler était le führer de l’Allemagne, une sorte de grand imam en casquette et blouson noir. En arrivant au pouvoir, il a apporté avec lui une nouvelle religion, le nazisme. Tous les Allemands portaient au cou la croix gammée, le truc qui voulait dire : Je suis nazi, je crois en Hitler, je vis par lui et pour lui. ».
Dans "Le Train d'Erlingen" : « Oui, l'Europe a peur de l'islamisme, elle est prête à tout lui céder. (…) La réalité en boucle n'a pas d'effet sur les gens, en apparence du moins. On l'a vu en Algérie durant la décennie noire : les gens qui, au début, s'émouvaient pour une victime du terrorisme ont fini après quelques mois de carnage par ne ressentir d'émotion que lorsque le nombre des victimes par jour dépassait la centaine, et encore devaient-elles avoir été tuées d'une manière particulièrement horrible. Terrible résultat : plus les islamistes gagnaient de terrain et redoublaient de cruauté, moins les gens réagissaient. L'info tue l'info, l'habitude est un sédatif puissant et la terreur, un paralysant violent. » (2018).
Sur la langue arabe : « L'Université (…), elle enseigne en arabe, ce qui se conçoit, à des étudiants qui ne pratiquent que leur langue et c'est marre [ça suffit !] : l'algérien, un sabir fait de tamazight, d'un arabe venu d'ailleurs, d'un turc médiéval, d'un français XIXe et d'un soupçon d'anglais new-age. » ("Le Serment des barbares", 1999).
1. Le 14 novembre 2024 ("Atelier de la langue française")
2. Le 8 octobre 2024 ("Front populaire")
3. Le 2 octobre 2024 ("Frontières")
4. Le 1er juillet 2023 ("Le Figaro")
5. Le 13 juin 2019 (Montpellier)
6. Le 12 octobre 2018 ("Dialogues")
Aussi sur le blog.
Sylvain Rakotoarison (25 novembre 2024)
http://www.rakotoarison.eu
Pour aller plus loin :
Boualem Sansal.
Le massacre d’Oran, 60 ans plus tard…
José Gonzalez.
Reconnaissance par Emmanuel Macron le 26 janvier 2022 de deux massacres commis en 1962 en Algérie (Alger et Oran).
Pierre Vidal-Naquet.
Jean Lacouture.
Edmond Michelet.
Jacques Soustelle.
Albert Camus.
Abdelaziz Bouteflika en 2021.
Le fantôme d’El Mouradia.
Louis Joxe et les Harkis.
Chadli Bendjedid.
Disparition de Chadli Benjedid.
Hocine Aït Ahmed.
Ahmed Ben Bella.
Josette Audin.
Michel Audin.
Déclaration d’Emmanuel Macron sur Maurice Audin (13 septembre 2018).
François Mitterrand et l'Algérie.
Hervé Gourdel.
Mohamed Boudiaf.
Vidéo : dernières paroles de Boudiaf le 29 juin 1992.
Rapport officiel sur l’assassinat de Boudiaf (texte intégral).
Abdelaziz Bouteflika en 2009.
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20241121-boualem-sansal.html
https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/liberez-boualem-sansal-257780
http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2024/11/23/article-sr-20241121-boualem-sansal.html
/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_5baf32_yartisansalboualem01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_eb0504_yartisansalboualem05.jpg)
/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_b5a72e_yartisansalboualem02.jpg)
/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_92fdc6_yartisansalboualem04.jpg)
/image%2F1488922%2F20241126%2Fob_6985f3_yartisansalboualem08.jpg)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_a2c074_yartivrignaultteddy01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_243696_yartivrignaultteddy04.jpg)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_033494_yartivrignaultteddy02.jpg)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_462274_yartivrignaultteddy05.jpg)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_ab3b8b_yartivrignaultteddy03.jpg)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_e7196b_yartikouchnerbernard01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_a77d78_yartikouchnerbernard03.jpg)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_153de0_yartikouchnerbernard04.jpg)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_5b23f5_yartikouchnerbernard02.jpg)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_2db76e_yartikouchnerbernard05.JPG)
/image%2F1488922%2F20241029%2Fob_a05d5f_yartikouchnerbernard08.jpg)
/image%2F1488922%2F20241027%2Fob_f75786_yartimitterranddanielle01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241028%2Fob_a5be73_yartimitterranddanielle07.jpg)
/image%2F1488922%2F20241028%2Fob_4bd1a9_yartimitterranddanielle08.jpg)
/image%2F1488922%2F20241028%2Fob_7b89f2_yartimitterranddanielle06.jpg)
/image%2F1488922%2F20241028%2Fob_015b3d_yartimitterranddanielle03.jpg)
/image%2F1488922%2F20241026%2Fob_f74913_yartibombardalain01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241026%2Fob_99abad_yartibombardalain02.jpg)
/image%2F1488922%2F20241026%2Fob_877f0c_yartibombardalain05.jpg)
/image%2F1488922%2F20241026%2Fob_3e928a_yartibombardalain03.jpg)
/image%2F1488922%2F20241026%2Fob_8d70a1_yartibombardalain04.jpg)

/image%2F1488922%2F20241012%2Fob_f61e09_yartireeveshubertb05.jpg)

/image%2F1488922%2F20241012%2Fob_73f260_yartiphilippulus04.jpg)
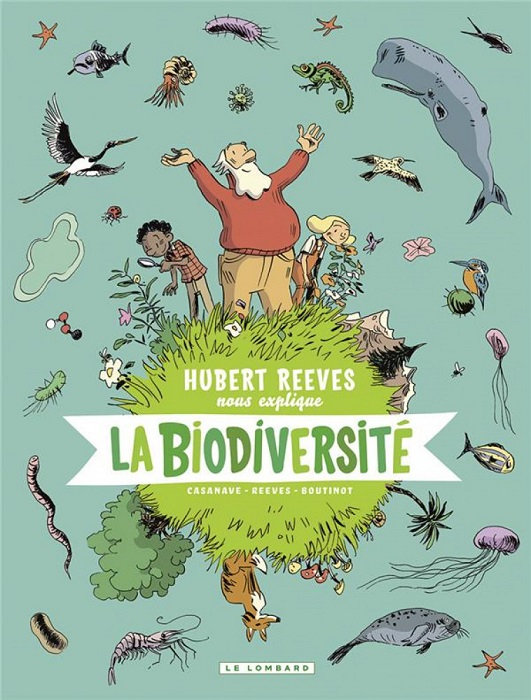
/image%2F1488922%2F20241012%2Fob_ae9ac0_yartifranceanatole08.jpg)

/image%2F1488922%2F20241012%2Fob_6f69bb_yartifranceanatole02.jpg)
/image%2F1488922%2F20241012%2Fob_9fc3b7_yartifranceanatole03.jpg)
/image%2F1488922%2F20241012%2Fob_707a98_yartifranceanatole01.jpg)
/image%2F1488922%2F20241012%2Fob_80d311_yartifranceanatole06.jpg)
/image%2F1488922%2F20241005%2Fob_a5b590_yartimassacre7octobre1an01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241005%2Fob_3293f0_yartimassacre7octobre1an02.jpg)
/image%2F1488922%2F20241005%2Fob_f7fde1_yartimassacre7octobre1an05.jpg)
/image%2F1488922%2F20241005%2Fob_e4eb41_yartimassacre7octobre1an06.jpg)
/image%2F1488922%2F20241005%2Fob_a3f8a3_yartimassacre7octobre1an03.jpg)
/image%2F1488922%2F20241005%2Fob_08975b_yartimassacre7octobre1an04.jpg)
/image%2F1488922%2F20241003%2Fob_209055_yartielkabbachc01.jpg)

/image%2F1488922%2F20241003%2Fob_23c8f8_yartielkabbachc02.jpg)
/image%2F1488922%2F20241003%2Fob_1acf65_yartielkabbachc03.jpg)
/image%2F1488922%2F20240930%2Fob_8617b8_yartidebrejeanlouisb01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240930%2Fob_edc5c6_yartidebrejeanlouisb05.jpg)
/image%2F1488922%2F20240930%2Fob_95acb2_yartidebrejeanlouisb02.jpg)
/image%2F1488922%2F20240930%2Fob_f72709_yartidebrejeanlouisb06.jpg)